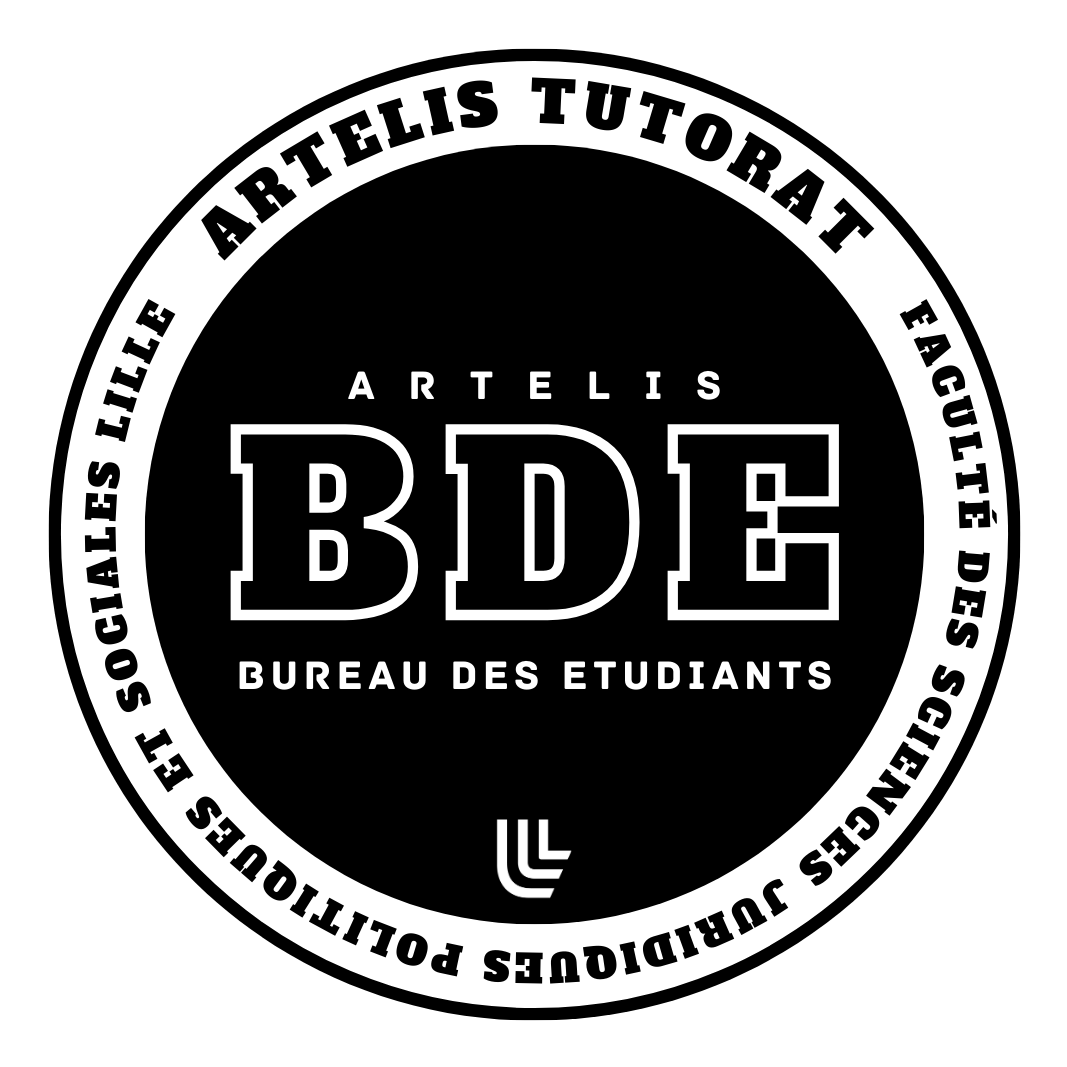Benjamin Fiorini est maitre de conférence en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris 8. Ce juriste est très vite devenu un fervent défenseur du jury populaire. Également président de l’association « Sauvons les assises ! », il revient dans une tribune pour La Voix d’Artelis sur son combat contre les cours criminelles départementales.

Benjamin Fiorini ©Radio France - Anne Fauquembergue
Le 8 février 2024, le Conseil constitutionnel validait définitivement le dispositif des cours criminelles départementales sans jury (CCD), écartant l’idée selon laquelle la participation des jurés citoyens au jugement des crimes serait un principe constitutionnel. Dans la nuit qui suivait, Robert Badinter, père de cette idée qu’il avait vaillamment défendue en tant que président du Conseil constitutionnel, s’éteignait. L’homme et le principe disparaissait dans un même souffle, emportant dans la nuit une certaine conception de la justice et de la démocratie.
Expérimentées depuis septembre 2019, puis généralisées sur l’ensemble du territoire à partir du 1er janvier 2023, les CCD sont chargées de juger les crimes commis hors récidive punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, soit 57% des affaires criminelles (dont environ 90% de viols). Contrairement aux cours d’assises qui jugeaient jusqu’alors ces crimes, leur principale caractéristique est de faire l’économie du jury populaire : tandis que les cours d’assises comprennent trois magistrats et six citoyens tirés au sort sur les listes électorales, les CCD sont seulement constituées de cinq magistrats. C’est la raison pour laquelle les CCD, acronyme rapidement détournée en « Crime Contre la Démocratie », ont été et demeurent vivement contestées.
D’aucuns pourraient penser que cette dilution du jury populaire a été dictée par la recherche sincère d’une meilleure justice ; que le gouvernement, après des travaux de fond finement documentés, est arrivé à la conclusion rationnelle qu’il était préférable de faire juger les crimes par des magistrats professionnels, et non par des juges d’un jour désignés par le sort. Or, il n’en est rien. Ce n’est absolument pas la quête d’une justice plus qualitative qui a commandé l’instauration des CCD (au contraire, l’excellence de la procédure d’assises n’a cessé d’être vantée au cours des débats parlementaires), mais bien des considérations gestionnaires liés à un souci général d’économies budgétaires, de résorbions des stocks et d’écoulement des flux de dossiers.
Le crime de la cour d’assises n’est pas d’avoir failli : il est d’être devenue incapable de rendre la justice dans des délais raisonnables, faute d’être suffisamment pourvue en moyens matériels et humains. Plutôt que de corriger en urgence ce problème, le gouvernement a donc fait le choix d’une justice plus rapide et moins onéreuse, quitte à en déprécier la teneur, tout en rompant avec la tradition révolutionnaire selon laquelle le jury était la traduction d’un double droit sacré : le droit des citoyens de participer aux jugements des crimes, et le droit des mêmes citoyens d’être jugés par leurs pairs. Comble de l’ironie : le premier bilan des CCD, sans appel, montre que les principales promesses ayant justifié leur création ne sont pas tenues. Le jury populaire, institution profondément enracinée dans notre inconscient judiciaire collectif, a donc été sacrifié pour un bénéfice nul.
Première promesse : les CCD devaient permettre de juger plus rapidement les affaires criminelles. Les premiers résultats enregistrés sont toutefois médiocres : s’il est vrai que les dossiers avec des accusés placés en détention provisoire sont jugés un petit peu plus rapidement qu’auparavant, cela a pour conséquence de faire juger moins rapidement, dans des proportions équivalentes, les accusés comparaissant libres. Il s’agit donc d’un jeu à somme nulle où il y a autant de gagnants que de perdants, comme l’explique le magistrat Michel Huyette. Début 2024, lors de la rentrée solennelle de la cour d’appel de Paris, la procureure générale Marie-Suzanne Le Quéau s’est d’ailleurs émue de l’incapacité des CCD à résorber les stocks d’affaires en instance. Il faut ajouter que d’après le dernier rapport d’évaluation sur cette question, les arrêts rendus par les CCD donnent lieu, à affaires équivalentes, à davantage d’appels que les cours d’assises. Même à admettre que du temps serait gagné en amont des procès devant les CCD, il est donc reperdu en aval. Comment voir dans ces résultats un quelconque progrès ?
Seconde promesse : les CCD devaient drastiquement limiter la correctionnalisation des viols, mécanisme par lequel ces crimes sont fictivement disqualifiés en agressions sexuelles pour être jugés plus rapidement par un tribunal correctionnel (avec, à la clé, des peines encourues beaucoup moins importantes). Parce qu’elles étaient censées accélérer le jugement des crimes, les CCD devaient, corrélativement, permettre de juger davantage de viols pour ce qu’ils sont. Hélas, le gain de temps n’étant pas au rendez-vous, les CCD n’ont entraîné aucun recul significatif de la correctionnalisation, comme a pu le constater le comité d’évaluation de la cour criminelle dans son rapport d’octobre 2022. Pire, depuis la généralisation du dispositif, un nouveau phénomène est régulièrement dénoncés par les collectifs féministes et avocats de parties civiles : d’une part, la tendance des CCD à prononcer des peines bradées dans les affaires de viol, pour dissuader les accusés de faire appel et d’engorger encore davantage la machine judiciaire ; d’autre part, l’apparition d’un phénomène de cour-criminalisation (ou sous-criminalisation), consistant pour les juges d’instruction à « oublier » de relever pour certains viols des circonstances aggravantes rendant normalement la cour d’assises compétente (c’est notamment le cas lorsqu’un viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie) dans l’unique but de réserver le jugement de ces affaires à leurs collègues magistrats. Ainsi, non seulement les CCD n’ont eu aucun impact notable sur la correctionnalisation, mais au surplus, elles ont généré un second mécanisme de sous-qualification des viols : difficile d’y voir une avancée pour la cause féministe !
Face à cet échec cuisant, il est plus qu’urgent de poursuivre le combat pour le rétablissement du jury populaire dans la plénitude de ses fonctions. Au fond, deux conceptions s’opposent radicalement : l’une, empreinte d’humanité, plaidant pour justice démocratique qui prend le temps de bien juger ; l’autre, d’essence technocratique, appréhendant la justice comme une machine à produire du chiffre selon une logique industrielle. L’association « Sauvons les assises ! » continuera à se mobiliser pour que la première conception l’emporte, et chacun est invité à rejoindre à ce combat.

©sauvonslesassises.fr